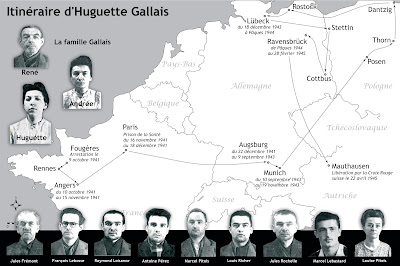|
| Ouest-France, 1955 |
Combien de Rennais
se souviennent de la foire de la Saint-Pierre qui se tenait chaque année le 29
juin sur le boulevard de la Liberté ? Avec la Saint-Michel, c’était une
date importante dans le monde paysan. Ce n’était pas une foire comme les
autres. On l’appelait la « Louée » ou la « Louerie de la
Saint-Pierre » ou bien encore « La gagerie de la Saint-Pierre ».
L’ANPE ou « Pôle Emploi » n’existant pas encore, la Saint-Pierre
était l’occasion pour les domestiques, garçons ou filles, de proposer leurs
services pour la métive.
La Louée coïncidait avec une autre fête, moins profane
celle-ci, et qui concluait l’année d’études au Séminaire avec « L’ordination
de la Saint-Pierre » à l’église Métropole. Souvent ruraux eux-aussi, les
jeunes ordinands, face prostrée contre le sol en signe de soumission complète à
Dieu, scellaient définitivement leur avenir en devenant « prêtres pour
l’éternité ».
Les Perrins et les Perrines
 |
| Ouest-Eclair, 1938 |
La Saint-Pierre
est un jour chômé dans toutes les fermes du pays de Rennes. Dès le matin,
arrivent à bicyclette ou descendent des tramways les domestiques qui ont donné
congé à leurs maitres et veulent s’assurer qu’ils ne seront pas plus mal ailleurs.
Appelés les Perrins, en référence à Pierre, les jeunes gens en longue
blouses bleues (en 1900) portent un épi de blé ou une fleur au ruban de leur chapeau.
Quelques uns ont brin de trèfle. Les Perrines ont une fleur passée dans la
piécette de leur tablier. Parmi ces domestiques et servantes proposant leurs
services, on remarque de solides gaillards avec un fouet à la main. Ce sont les
charretiers, qui sont les personnages les plus considérés à la ferme.
Viennent ensuite
les métayers et leurs bourgeoises. Ils doivent avoir le coup d’œil pour choisir
les bons domestiques, car à la campagne, note un journaliste en 1900 :
« La force, la santé passent avant
l’intelligence. De plus il faut avoir une bonne dentition pour affronter les
nombreux repas de galettes et de pain rassis, car si les maitres exigent du
travail, ils n’aiment guère les domestiques sans appétit. » Les
Perrins et les Perrines qui déambulent sur le boulevard ne cherchent pas tous
du travail. Ils tiennent à respecter cette coutume et veulent connaitre les
tarifs de louage. Jour de congé, la Louée est aussi une occasion de sortie et
de rencontres autour des attractions et manèges installés sur le Champ de Mars.
La louerie
La louerie se
fait de deux façons différentes : soit pour l’année entière, soit pour la
métive. La métive correspond à la période de la moisson, c’est-à-dire les mois
de juillet, août, et septembre. Estimant cette période trop courte, le syndicat
des agriculteurs s’adressera à la préfecture pour rallonger cette période d’un
mois, au même tarif, en permettant l’embauche début juin de façon à ce que ces
ouvriers agricoles travaillent non seulement pour la moisson mais aussi pour la
fenaison. Il n’y aura pas de suite.
Ce jour-là donc,
les patrons lorgnent à gauche et à droite sous les vertes frondaisons du
boulevard de la Liberté à la recherche du garçon le plus robuste sur lequel ils
porteront leur choix. Le contact établi, les négociations commencent :
- Es-tu
embauché ?- Pas encore.
- Alors ! Combien demandes-tu… Fais ton prix… Je t’écoute…
- 2 000 francs !
- Diable 2 000 francs ! C’est bien cher pour trois mois de métive.
La discussion va
continuer car le garçon ne veut pas en démordre. Enfin, après des
« mais » et des « si » le marché est conclu. L’affaire sera
concrétisée définitivement devant la bolée de cidre réglementaire. Il n’y a pas
de contrat écrit, seule la parole compte et le fermier verse des arrhes. C’est
le « denier de Dieu », qui autrefois était une pièce d’argent versée
pour sceller une entente verbale. A la différence des arrhes, il n’est pas
compté dans la transaction. Ce pécule permet surtout aux Perrines de faire
quelques emplettes à la foire et aux Perrins de faire le tour des débits de
boisson. La soirée est souvent mouvementée. La police ramasse parfois des
Perrins qui n’ont pas trouvé de place mais rencontré beaucoup d’auberges.
Les tarifs
demandés ou proposés fluctuent évidemment en fonction de l’offre et de la
demande, mais aussi de la situation économique du moment. En 1900 « Les domestiques reçoivent aujourd’hui des
gages de plus en plus élevés parce qu’ils trouvent des placements avec une
grande facilité. Les agences de Beauce et de Normandie viennent les chercher
sur ce Champ de Mars et les filles de fermes sont expédiées directement sur la
région parisienne où elles sont généralement recherchées pour leur honnêteté et
leur bonne conduite. »
Je n’ai pas
réussi à dater l’origine de cette coutume que l’on dit très ancienne. Même
pendant les deux conflits mondiaux, la Louée ne sera pas interrompue. L’Ouest-Éclair de 1915 informe ses
lecteurs que si habituellement le boulevard de la Liberté présente une
animation inaccoutumée « Malheureusement
la guerre est venue déroger à cette vieille coutume. Á part jeunes filles et
vieilles femmes en coiffe, on vit peu de monde. Il faut dire aussi que presque
tous nos campagnards sont mobilisés. » Les salaires étant bloqués
depuis 1914, alors que les prix s’envolent, on observe de nombreuses grèves en
1919. Pour le journal « La vie est
chère et les Perrins et Perrines ont sérieusement augmenté leurs prix. En 1917,
ils demandaient 500 F pour trois mois ou 1 100 à 1 200 F pour
l’année. C’était déjà cher, mais tout n’a-t-il pas encore renchéri ? Les
ouvriers n’ont-ils pas vu leurs salaires augmenter dans de très fortes
proportions ? Les Perrins suivent le mouvement. » En 1925, les
Perrins obtiennent 1 500 a 1 800 francs pour les trois mois, on est
même monté à 2 000 francs. En 1929, c’est 2 500 francs pour les trois
mois. En 1930, on descend à 1 800, voir 1 500 francs.
 |
| L'Ouest-Eclair, 1939 |
L’occupation
allemande ne sera évidemment pas sans conséquence sur le déroulement de la
Louée. Comme le signale L’Ouest-Éclair de
1942, Perrins et Perrines n’ont visiblement pas la tête à faire la fête. « Le décalage de l’heure et le peu d’envie
qu’ils avaient de déjeuner maigrement en ville furent cause qu’ils n’arrivèrent
guère que l’après-midi. Le matin ils n’étaient qu’en petit nombre et l’on put
croire que l’offre ne suffirait pas à la demande. Mais l’après-midi il y eut
une grande affluence. » En 1944, malgré les bombardements des 9 et 12
juin, la Louée est maintenue « A
vrai dire Perrins et Perrines n’étaient point trop satisfaits. Car les engagements
ne se pratiquaient guère aux tarifs qu’ils réclamaient « Dame, nous disait
l’un d’eux, avec tous les « villotins » aujourd’hui réfugiés à la
campagne et qui louent leurs services pour une bouchée de pain, il n’est guère
facile de dénicher une bonne place. La journée fut cependant sans gaieté, car
il manquait pour rappeler les joyeuses Saint-Pierre d’avant 1939 les flonflons
des musiques mécaniques et aussi – ce qui est plus grave – le cidre coulant à
flot dans les bolées devant lesquelles se traitaient les contrats. »
 |
| Ouest-France, 1961 |
La louée
retrouvera quelque vigueur après le conflit. Mais, en 1960, conséquence de la
construction de la salle omnisports sur le Champs de Mars, la Louée est
transférée sur le Mail. Une autre édition, peut-être la dernière, aura lieu en
1961. L’auteur de ces lignes, ni fort ni intelligent, mais en vacances au début des années 60 à Saint-Just, dans ce pauvre pays de Redon, se souvient parfaitement des bœufs attelés de la modeste ferme voisine. Gamins de la ville, accompagnant les enfants de cette ferme, nous étions plus nombreux que les vaches dont nous avions la garde. Lors des moissons,
les gerbes étaient faites à la main par les femmes et les battages s’effectuaient avec
l’imposante batteuse. La généralisation du tracteur et de la moissonneuse-batteuse,
à condition qu’elle puisse entrer dans ces champs entourés de palis, va révolutionner
les moissons et sonner le glas des Perrins et Perrines.